

| Accueil |
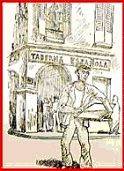

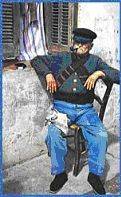
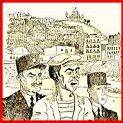
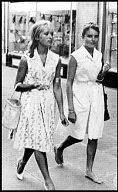


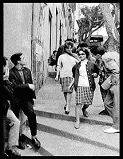


Regard sur Pointe Pescade , suite
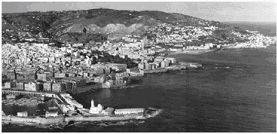
La baroufa
Le coup de théâtre attendu se produit. Zorro et la justice triomphent. Happy end. Chacun est bien
content, mais on a eu chaud!
A la sortie, une baroufa (dispute) éclate, imprévisible, soudaine comme orage de septembre sur le
cap Matifou.
Deux jeunes coqs se dressent face à face:
- Tu te crois, pourquoi que tu t'es payé le balcon plus cher ,tu te crois, la mort de tes bis, tu te crois le
droit que tu me jettes à moi, que je suis en bas bien tranquille , tes peaux d'orange, tes pluchures,
(tes épluchures) et tes saletés ! Eh bien Zoubia! (bernique!) je vas t'apprendre moi, à être propre !
- Qu'est-ce tu vas m'apprendre? Tant plus elle parle ta langue vilaine, tant plus i me monte le bœuf,
elle me vient la rabia (la colère me prend); approche un peu si ti es un homme!
C'est lancé, l'honneur est en jeu, l'honneur, que c'est plus que le "pèze". Aucun des deux champions
ne veut perdre la fugure (la face), d'autant que le public est déjà nombreux .Les injures fusent dans
leur diversité infinie, dans leur truculente richesse : Falso! (faux jeton), falampo! (hypocrite),
mesloute! (crève-la-faim), coulo, caouette! (pédéraste), va fangoule ! va te pilancoul la figa de ta
ouèla! (ici, la traduction braverait l'honnêteté).
Des ansultes (insultes) à la famille, aux morts, à la race et à la religion de l'adversaire, on passe aux
coups. La bagarre dure jusqu'à l'arrivée de la police (contre laquelle un front commun se forme
aussitôt) ou jusqu'à l'intervention, plus fréquente, des médiateurs et des conciliateurs : Allez, basta!
Baraka ! (ça suffit). Le défoulement ayant été immédiat et violent, la fièvre retombe aussi vite qu'elle
était montée. Parfois, les deux adversaires " se touchent la main " dans une réconciliation
sentimentale . aussi brusque, excessive, déroutante, que l'empoignade, déjà oubliée.
La baroufa prolonge jusqu'à l'âge le plus avancé la période de l'enfance et de l'adolescence où
l'éducation collective du groupe enseigne que rien n'est plus important que l'étalage du courage
physique, vertu particulièrement prisée en Algérie, et dans les deux communautés. La donnade
(explication à coups de poing) entre deux élèves à la sortie de la classe, devant le cercle des
condisciples connaisseurs, fait partie de la vie scolaire à Bab-el-Oued.
Dans la baroufa, l'éloquence lyrique trouve son compte autant que la bravoure. Le goût du théâtre
aussi. Chez les femmes comme chez les hommes.
A propos de bottes d'oignons, de seaux d'eau dans l'escalier ou de la blancheur comparée du linge
séchant aux fenêtres, la querelle de palier entre deux commères, fortes en gueule, devient un
spectacle haut en couleur et en bruit, gratuitement offert aux voisins accourus dès les premiers
éclats du tcheklala (scandale).
Des voix aiguës portent sur la place publique, avec des commentaires glapissants, les stupres
respectifs des familles rivales, depuis la faute publique de l'arrière-grand-mère jusqu'au chômage
prolongé et honteux de l'oncle parasite. Les messieurs, pressés par les dames de montrer leur
virilité, de combattre, de se jeter dans la mêlée, préfèrent en général réserver pour de meilleures
causes leurs " coups de savate ou leurs " coups de tête empoisonnés.
Les tchatcheurs
Des cafés, il y en a, à Bab-el-Oued, de toutes les couleurs criardes des devantures ou des fresques
naïves décorant les salles. Il y en a pour tous le goûts, politiques ou sportifs, depuis la " Grande
Brasserie " pour les amateurs de billard, jusqu'à " Pilor ", pour les républicains espagnols, en
passant par la " Brasserie olympique ", la " Brasserie des avenues ", le " Café de Barcelone" "
Algéria "," la Butte ", faussement montmartroise, le " Sélect " - j'en passe, et des meilleurs pour ce
qui est de la kémia.
Amuse-gueule, zakouski à l'algérienne, les ingrédients de la kémia varient selon les cafés dont les
patrons mettent leur point d'honneur à " servir une spécialité tout à fait spéciale ". Citons, dans le
désordre, les olives noire et vertes, les rondelles de tomate, le carottes vinaigrées, les bouts de
fromage en dés ou en lamelles, les saucisses minuscules, le saucisson en tranches, le sardines en
friture, les anchois, le " caviar oranais ", les pistaches, les cacahuètes salées, les amandes grillées,
le bliblis (petits pois chiches grillés, durs et croquants) sans oublier la loubia, le bol( de haricots
secs, cuits dans une sauce rougie par le piment et le koumoun (cumin).
Elle est savoureuse, la kémia. Elle est le complément, le faire-valoir indispensable de l'anisette,
qu'elle donne la force le courage et tout. L'anisette surclasse ses cousins de Méditerranée, le pastis
provençal, l'ouzo grec ou le raki moyen oriental. Elle établit un lien chaleureux entre les trois sortes
de clients du café les voyeurs, les joueurs et les parleurs.
Les voyeurs s'installent à la terrasse en épicuriens pour boire le soleil qu'il vous dit bonjour et pour
lorgner les jolies filles qui passent dans la rue (les femmes dans les cafés, sont toujours
accompagnées), souvent gaies et souriantes.
Les joueurs, à l'intérieur, font d'interminables parties de dés, de dames, de dominos, de cartes. Ils
jouent au rami, à la bisque, à la belote et à sa variante autochtone, le touti, mais surtout à la ronda.
Le coup de théâtre attendu se produit. Zorro et la justice triomphent. Happy end. Chacun est bien
content, mais on a eu chaud!
A la sortie, une baroufa (dispute) éclate, imprévisible, soudaine comme orage de septembre sur le
cap Matifou.
Deux jeunes coqs se dressent face à face:
- Tu te crois, pourquoi que tu t'es payé le balcon plus cher ,tu te crois, la mort de tes bis, tu te crois le
droit que tu me jettes à moi, que je suis en bas bien tranquille , tes peaux d'orange, tes pluchures,
(tes épluchures) et tes saletés ! Eh bien Zoubia! (bernique!) je vas t'apprendre moi, à être propre !
- Qu'est-ce tu vas m'apprendre? Tant plus elle parle ta langue vilaine, tant plus i me monte le bœuf,
elle me vient la rabia (la colère me prend); approche un peu si ti es un homme!
C'est lancé, l'honneur est en jeu, l'honneur, que c'est plus que le "pèze". Aucun des deux champions
ne veut perdre la fugure (la face), d'autant que le public est déjà nombreux .Les injures fusent dans
leur diversité infinie, dans leur truculente richesse : Falso! (faux jeton), falampo! (hypocrite),
mesloute! (crève-la-faim), coulo, caouette! (pédéraste), va fangoule ! va te pilancoul la figa de ta
ouèla! (ici, la traduction braverait l'honnêteté).
Des ansultes (insultes) à la famille, aux morts, à la race et à la religion de l'adversaire, on passe aux
coups. La bagarre dure jusqu'à l'arrivée de la police (contre laquelle un front commun se forme
aussitôt) ou jusqu'à l'intervention, plus fréquente, des médiateurs et des conciliateurs : Allez, basta!
Baraka ! (ça suffit). Le défoulement ayant été immédiat et violent, la fièvre retombe aussi vite qu'elle
était montée. Parfois, les deux adversaires " se touchent la main " dans une réconciliation
sentimentale . aussi brusque, excessive, déroutante, que l'empoignade, déjà oubliée.
La baroufa prolonge jusqu'à l'âge le plus avancé la période de l'enfance et de l'adolescence où
l'éducation collective du groupe enseigne que rien n'est plus important que l'étalage du courage
physique, vertu particulièrement prisée en Algérie, et dans les deux communautés. La donnade
(explication à coups de poing) entre deux élèves à la sortie de la classe, devant le cercle des
condisciples connaisseurs, fait partie de la vie scolaire à Bab-el-Oued.
Dans la baroufa, l'éloquence lyrique trouve son compte autant que la bravoure. Le goût du théâtre
aussi. Chez les femmes comme chez les hommes.
A propos de bottes d'oignons, de seaux d'eau dans l'escalier ou de la blancheur comparée du linge
séchant aux fenêtres, la querelle de palier entre deux commères, fortes en gueule, devient un
spectacle haut en couleur et en bruit, gratuitement offert aux voisins accourus dès les premiers
éclats du tcheklala (scandale).
Des voix aiguës portent sur la place publique, avec des commentaires glapissants, les stupres
respectifs des familles rivales, depuis la faute publique de l'arrière-grand-mère jusqu'au chômage
prolongé et honteux de l'oncle parasite. Les messieurs, pressés par les dames de montrer leur
virilité, de combattre, de se jeter dans la mêlée, préfèrent en général réserver pour de meilleures
causes leurs " coups de savate ou leurs " coups de tête empoisonnés.
Les tchatcheurs
Des cafés, il y en a, à Bab-el-Oued, de toutes les couleurs criardes des devantures ou des fresques
naïves décorant les salles. Il y en a pour tous le goûts, politiques ou sportifs, depuis la " Grande
Brasserie " pour les amateurs de billard, jusqu'à " Pilor ", pour les républicains espagnols, en
passant par la " Brasserie olympique ", la " Brasserie des avenues ", le " Café de Barcelone" "
Algéria "," la Butte ", faussement montmartroise, le " Sélect " - j'en passe, et des meilleurs pour ce
qui est de la kémia.
Amuse-gueule, zakouski à l'algérienne, les ingrédients de la kémia varient selon les cafés dont les
patrons mettent leur point d'honneur à " servir une spécialité tout à fait spéciale ". Citons, dans le
désordre, les olives noire et vertes, les rondelles de tomate, le carottes vinaigrées, les bouts de
fromage en dés ou en lamelles, les saucisses minuscules, le saucisson en tranches, le sardines en
friture, les anchois, le " caviar oranais ", les pistaches, les cacahuètes salées, les amandes grillées,
le bliblis (petits pois chiches grillés, durs et croquants) sans oublier la loubia, le bol( de haricots
secs, cuits dans une sauce rougie par le piment et le koumoun (cumin).
Elle est savoureuse, la kémia. Elle est le complément, le faire-valoir indispensable de l'anisette,
qu'elle donne la force le courage et tout. L'anisette surclasse ses cousins de Méditerranée, le pastis
provençal, l'ouzo grec ou le raki moyen oriental. Elle établit un lien chaleureux entre les trois sortes
de clients du café les voyeurs, les joueurs et les parleurs.
Les voyeurs s'installent à la terrasse en épicuriens pour boire le soleil qu'il vous dit bonjour et pour
lorgner les jolies filles qui passent dans la rue (les femmes dans les cafés, sont toujours
accompagnées), souvent gaies et souriantes.
Les joueurs, à l'intérieur, font d'interminables parties de dés, de dames, de dominos, de cartes. Ils
jouent au rami, à la bisque, à la belote et à sa variante autochtone, le touti, mais surtout à la ronda.
Mon ami Pedro, sa femme Maria et leurs deux fils, Pépé et Tonio, habitent un logement bien rangé,
mais laidement meublé. C'est qu'ils ignorent, Pedro et Maria, les raffinements de la décoration et, au
surplus, ils ne s'intéressent guère à l'esthétique des appartements. Si, à Bab-el-Oued, on aime
mieux dihors que dedans, c'est qu'on préfère la beauté de la nature à celle des objets. C'est non pas
dedans, mais dehors, sur le balcon, que Pedro va boire son bol de café au lait avant de partir pour le
travail.
Il est caissier dans un restaurant. Son salaire est maigre. Maria, qui va faire ses emplettes au
marché des Trois-Horloges, a peu à dépenser et elle marchande dur dans les boutiques, ce qui ne
l'empêche pas de tenir, en même temps, de longues conversations avec les commères bavardes du
quartier. Les autres familles sont à l'image de celles de Pedro et de Maria. Les citoyens de
Bab-el-Oued : petits fonctionnaires, petits commerçants, petits artisans; bref, de petites gens. Un
monde les sépare des bourgeois de la rue Michelet.
Pedro, qui se lève tôt, se couche également tôt, mais il réserve certaines heures de ses soirées aux
activités musicales et sportives, qui sont multiples à Bab-el-Oued. Accordéoniste, il répète avec les
autres membres d'un petit orchestre dans une cave dont les voûtes ne sont pas assez profondes
pour étouffer les flonflons, qu'on entend, et de loin, dans la nuit. Membre du bureau directeur d'une
société de joueurs de boules, il passe, parfois, après dîner, " au bureau " pour régler les problèmes
de cotisations, de constitution des quadrettes et de calendrier de championnat.
Des lourdes responsabilités lui permettent de tenir bon pendant les mois d'hiver, où le ciel, il pleure
la pluie, et d'arriver, avec un moral élevé, au temps chaud, marqué par deux exercices essentiels, la
sieste et le bain.
La sieste, explique-t-il, c'est bon avant, pendant et après. Avant, parce que, pendant que je me fais
mes additions, je me sens déjà que je dors. Pendant, parce que, pendant le sommeil, les forces de
l'homme elles se renforcent. Après, parce que, quand Je saute du lit et que Je mets mon pied chaud
sur le parterre froid, le carreau, c'est comme s'il me fait une caresse.
Se taper le bain en bas la mer est un autre plaisir des dieux, surtout si la cérémonie se déroule sur la
plage proche du boulevard Guillemin, notre croisette si Bab-el-Oued ce serait Cannes, autour de
l'établissement balnéaire et " festival " portant fièrement le nom de son propriétaire, Padovani. Il ne
semble pourtant pas très accueillant, ce rivage : l'eau n'y est guère pure et des oursins aux piquants
traîtres se cachent sous les rochers pointus. Si vous aimez vraiment nager, vous feriez mieux d'aller
sur d'autres plages, à la Madrague, aux Deux-Moulins, juste là en dessous où il s'arrête l'autobus, à
la Pointe-Pescade, fief de Raymond Laquière, président de l'Assemblée algérienne, aux Bains
romains, à Sidi-Ferruch, au bout du bout de la baie. Mais si vous voulez être à l'unisson de
Bab-el-Oued, vous direz, comme tout le monde, Pado, c'est Pado. Pado immémorial, irremplaçable.
A 18 h 30, l'heure de la " fraîche ", le boulevard Guillemin, avec ses ficus et ses trottoirs étroits, et
l'avenue de Bouzaréa, jusqu'à la rampe métallique de l'avenue Durando, deviennent les hauts lieux
de Bab-ed-Oued. C'est là, en effet, que la jeunesse retrouve la tradition espagnole du paseo, de
l'altière promenade.
Pour rire et pour pleurer
Les couples sont rares. Trois ou quatre garçons, habillés avec une négligence étudiée (Comment
que tu le mets, ton foulard? C'est important le foulard), marchent côte à côte sur la chaussée. Les
filles, elles aussi, " font l'avenue ", par groupes jacassants et gloussants. On s'observe
sournoisement, on s'interpelle avec plus ou moins d'esprit, ou de bonheur. Des clins d'oeil
s'échangent, les coups de foudre éclatent.
Le samedi après-midi ou le samedi soir, Pedro s'en va, avec la famille ou les amis, au cinéma, au "
Palace " ou au " Petit-Casino ", mais de préférence, au " Majestic " dont tout Bab-el-Oued est fier
parce qu'il possède une belle enseigne au néon parce qu'il a été construit patriotique, en 1930, pour
les fêtes zanniversaires de la conquête et parce qu'il est le plus grand de toute l'Afrique du Nord.
Le problème de la sélection du film est vite réglé. On choisit, pour les dames, un musical (une
histoire chantante et roucoulante, hispanique ou sud-américaine) ou un triste qui vous tire les
larmes, à moins que ce ne soit, pour les mâles un aventure (Jim la Jungle, Tarzan, Zorro) ou un
western (les Américains contre les bandits).
Les hommes prennent les places et s'entassent avec les femmes, les enfants, les couffins, les
sandwiches (pour çui-là q'il a faim à l'entracte et même avant), les oranges, les bouteilles de
limonade, les bonbons acidulés, les paquets de cacahuètes et les cigarettes Bastos. La lumière
s'éteint. Les " mamas " cherchent à faire taire leur progéniture avec un succès relatif.
Sur l'écran, l'intrigue se noue. Au moment pathétique, quand le traître semble sur le point de vaincre
le héros, le public, spontanément manichéen et intensément participationniste, réagit bruyamment,
dans un tumulte indescriptible. Le cinéma est dans la salle. Des spectateurs interpellent une ombre,
en hurlant : Entention (attention), Zorro, entention! Il est derrière toi, il va te niquer le beignet! (te faire
un mauvais sort). Retourne-toi, mets-lui un taquet (un coup de poing); prends ton pétard et tire, la
mort de ton âme, tire! Mais qu'est-ce ti attends? Si tu le tues pas, c'est lui qui te tue.
mais laidement meublé. C'est qu'ils ignorent, Pedro et Maria, les raffinements de la décoration et, au
surplus, ils ne s'intéressent guère à l'esthétique des appartements. Si, à Bab-el-Oued, on aime
mieux dihors que dedans, c'est qu'on préfère la beauté de la nature à celle des objets. C'est non pas
dedans, mais dehors, sur le balcon, que Pedro va boire son bol de café au lait avant de partir pour le
travail.
Il est caissier dans un restaurant. Son salaire est maigre. Maria, qui va faire ses emplettes au
marché des Trois-Horloges, a peu à dépenser et elle marchande dur dans les boutiques, ce qui ne
l'empêche pas de tenir, en même temps, de longues conversations avec les commères bavardes du
quartier. Les autres familles sont à l'image de celles de Pedro et de Maria. Les citoyens de
Bab-el-Oued : petits fonctionnaires, petits commerçants, petits artisans; bref, de petites gens. Un
monde les sépare des bourgeois de la rue Michelet.
Pedro, qui se lève tôt, se couche également tôt, mais il réserve certaines heures de ses soirées aux
activités musicales et sportives, qui sont multiples à Bab-el-Oued. Accordéoniste, il répète avec les
autres membres d'un petit orchestre dans une cave dont les voûtes ne sont pas assez profondes
pour étouffer les flonflons, qu'on entend, et de loin, dans la nuit. Membre du bureau directeur d'une
société de joueurs de boules, il passe, parfois, après dîner, " au bureau " pour régler les problèmes
de cotisations, de constitution des quadrettes et de calendrier de championnat.
Des lourdes responsabilités lui permettent de tenir bon pendant les mois d'hiver, où le ciel, il pleure
la pluie, et d'arriver, avec un moral élevé, au temps chaud, marqué par deux exercices essentiels, la
sieste et le bain.
La sieste, explique-t-il, c'est bon avant, pendant et après. Avant, parce que, pendant que je me fais
mes additions, je me sens déjà que je dors. Pendant, parce que, pendant le sommeil, les forces de
l'homme elles se renforcent. Après, parce que, quand Je saute du lit et que Je mets mon pied chaud
sur le parterre froid, le carreau, c'est comme s'il me fait une caresse.
Se taper le bain en bas la mer est un autre plaisir des dieux, surtout si la cérémonie se déroule sur la
plage proche du boulevard Guillemin, notre croisette si Bab-el-Oued ce serait Cannes, autour de
l'établissement balnéaire et " festival " portant fièrement le nom de son propriétaire, Padovani. Il ne
semble pourtant pas très accueillant, ce rivage : l'eau n'y est guère pure et des oursins aux piquants
traîtres se cachent sous les rochers pointus. Si vous aimez vraiment nager, vous feriez mieux d'aller
sur d'autres plages, à la Madrague, aux Deux-Moulins, juste là en dessous où il s'arrête l'autobus, à
la Pointe-Pescade, fief de Raymond Laquière, président de l'Assemblée algérienne, aux Bains
romains, à Sidi-Ferruch, au bout du bout de la baie. Mais si vous voulez être à l'unisson de
Bab-el-Oued, vous direz, comme tout le monde, Pado, c'est Pado. Pado immémorial, irremplaçable.
A 18 h 30, l'heure de la " fraîche ", le boulevard Guillemin, avec ses ficus et ses trottoirs étroits, et
l'avenue de Bouzaréa, jusqu'à la rampe métallique de l'avenue Durando, deviennent les hauts lieux
de Bab-ed-Oued. C'est là, en effet, que la jeunesse retrouve la tradition espagnole du paseo, de
l'altière promenade.
Pour rire et pour pleurer
Les couples sont rares. Trois ou quatre garçons, habillés avec une négligence étudiée (Comment
que tu le mets, ton foulard? C'est important le foulard), marchent côte à côte sur la chaussée. Les
filles, elles aussi, " font l'avenue ", par groupes jacassants et gloussants. On s'observe
sournoisement, on s'interpelle avec plus ou moins d'esprit, ou de bonheur. Des clins d'oeil
s'échangent, les coups de foudre éclatent.
Le samedi après-midi ou le samedi soir, Pedro s'en va, avec la famille ou les amis, au cinéma, au "
Palace " ou au " Petit-Casino ", mais de préférence, au " Majestic " dont tout Bab-el-Oued est fier
parce qu'il possède une belle enseigne au néon parce qu'il a été construit patriotique, en 1930, pour
les fêtes zanniversaires de la conquête et parce qu'il est le plus grand de toute l'Afrique du Nord.
Le problème de la sélection du film est vite réglé. On choisit, pour les dames, un musical (une
histoire chantante et roucoulante, hispanique ou sud-américaine) ou un triste qui vous tire les
larmes, à moins que ce ne soit, pour les mâles un aventure (Jim la Jungle, Tarzan, Zorro) ou un
western (les Américains contre les bandits).
Les hommes prennent les places et s'entassent avec les femmes, les enfants, les couffins, les
sandwiches (pour çui-là q'il a faim à l'entracte et même avant), les oranges, les bouteilles de
limonade, les bonbons acidulés, les paquets de cacahuètes et les cigarettes Bastos. La lumière
s'éteint. Les " mamas " cherchent à faire taire leur progéniture avec un succès relatif.
Sur l'écran, l'intrigue se noue. Au moment pathétique, quand le traître semble sur le point de vaincre
le héros, le public, spontanément manichéen et intensément participationniste, réagit bruyamment,
dans un tumulte indescriptible. Le cinéma est dans la salle. Des spectateurs interpellent une ombre,
en hurlant : Entention (attention), Zorro, entention! Il est derrière toi, il va te niquer le beignet! (te faire
un mauvais sort). Retourne-toi, mets-lui un taquet (un coup de poing); prends ton pétard et tire, la
mort de ton âme, tire! Mais qu'est-ce ti attends? Si tu le tues pas, c'est lui qui te tue.
Bab El Oued, St Eugene, Les Deux Moulins, Pointe-Pescade, Bains Romains,
Sidi-Ferruch …
Au commencement c'était le bidonville. Il s'étendait, en 1871, aux confins d'Alger, au-delà de la "
Porte de la Rivière " Bab-el-Oued en arabe, Bablouette en langage du cru. Seuls, trois bâtiments en
dur dominaient les gourbis : l'arsenal, le stand de tir de l'armée et le lavoir.
Les maçons qui construisent des maisons dignes de ce nom viennent de Valence ou des Baléares.
On voit arriver ensuite d'autres Espagnols, des paysans de la province d'Alicante, qui deviennent
maraîchers, des juifs sefardim, auxquels le décret Crémieux accorde la nationalité française, des
gitans tondeurs de chiens, rempailleurs de chaises et diseurs de bonne aventure. Les Maltais
suivent; certains sont transporteurs, ou meuniers lorsque s'édifie la " cité des Moulins ". D'autres
font paître leurs chèvres sur les flancs de la colline de Bouzaréa, au Frais-Vallon notamment, et
descendent vendre du lait, à domicile, aux clients. Les premiers mariages mixtes sont célébrés, car
les Espagnols ne sont pas insensibles au charme sauvage des brunes maltaises.
Gagayous un héros pittoresque
En 1900, on peut parler de Bab-el-Oued les Deux-Églises. On a, en effet, construit l'église
Saint-Joseph, tarabiscotée comme une pièce de pâtisserie saupoudrée de sucre, et cette blanche
construction fait face à la silhouette jaune de Notre-Dame d'Afrique " Madame l'Afrique ",disent les
Algériens de la Casbah, également bâtie, à cette époque, sur les hauteurs. Le tramway, dont les rails
suivent la côte jusqu'à la corniche de Saint-Eugène , succède à la voiture à chevaux, aïeule de tous
les transports en commun.
Au début du siècle, de lourdes bâtisses aux façades blanches ou ocre, construites dans un style
colonial que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les villes hispaniques des Caraïbes, transforment
le paysage entre la colline de Bouzaréa et l'étroite bande de sable jaune longeant la mer, face aux "
bains Matarese ". Le coeur de cet ensemble est la place des Trois-Horloges, qui doit son nom, en
fait, à une seule horloge à trois cadrans, étonnante pièce de fonte surmontée d'une grosse boule
blanche.
Le publiciste Auguste Robinet, dit Musette, campe, dans un livre bien vite célèbre, le héros
picaresque qui symbolise tout Bab-el-Oued : Cagayous. On voit vivre, dans le petit monde de
Cagayous, tous les acteurs bien typés de la commedia dell'arte que joue, pour les autres et pour
lui-même, le petit peuple du quartier : Chicanelle, ma soeur, pôvre, qu'elle élève toute seule le petit
Scaragolette, Calcidone, le pêcheur d'oursins, Pimient, le marchand de tabac, Coimbra, le fossoyeur,
Mecieur Hoc, le facteur, Courro le fier-à-bras, Bacora le guitariste, Félisque le ténor, Embrouilloune,
l'Apolitain (le Napolitain), Ugène, le louette (le rusé), Fartasse (le Chauve), tape-à-l'oeil, Gasparette et,
enfin, çui-là qu'il a la calotte jaune, l'homme qui se cache de la police et dont on ne connaîtra jamais
que ce long pseudonyme.
Entre les deux guerres, les Siciliens, qui s'étaient d'abord dirigés sur Chiffalo, et les Napolitains, qui
avaient d'abord mis le cap sur Philippeville et Bône, prennent partiellement le relais de l'émigration
espagnole et viennent se fondre, avec quelques Français méridionaux, dans le melting pot
méditerranéen, dans le grand mélange qui donne à Bab-el-Oued son originalité pittoresque et
colorée. Si l'on descend l'avenue Durandon, on peut voir que cette frontière sépare le vieux
Bab-el-Oued des rivages ibériques, à gauche, du néo-Bab-el-Oued du Mezzogiorno italien, à droite.
Le pataouète, " ce rameau sur la souche des langues d'oc ", selon l'excellente définition de Gabriel
Audisio, continue à forger impétueusement, sur une toile de fond française, sa syntaxe exubérante
et son vocabulaire concret empruntant sans complexe ses locutions à l'espagnol - catalan,
valencien ou castillan -, aux versions napolitaine et sicilienne de l'italien, au maltais, au provençal, à
l'arabe.
En 1956, l'influence spécifiquement française s'est fortement accentuée et le pataouète, tout en
demeurant largement ésotérique pour le francaoui (le métropolitain), s'est tout de même rapproché
du français naturel, celui qu'on parle en Beauce ou en Touraine. Un certain vent de modernisme a,
d'autre part, soufflé sur Bab-el-Oued, dont la population ne cesse de s'accroître (80000 habitants en
1952, 100000 quatre ans plus tard).
Les H. L. M. poussent maintenant comme des champignons sur les terrains vagues et parfois à la
place de vieilles maisons rasées. Des voitures de plus en plus nombreuses sillonnent des rues de
plus en plus embouteillées.
Sidi-Ferruch …
Au commencement c'était le bidonville. Il s'étendait, en 1871, aux confins d'Alger, au-delà de la "
Porte de la Rivière " Bab-el-Oued en arabe, Bablouette en langage du cru. Seuls, trois bâtiments en
dur dominaient les gourbis : l'arsenal, le stand de tir de l'armée et le lavoir.
Les maçons qui construisent des maisons dignes de ce nom viennent de Valence ou des Baléares.
On voit arriver ensuite d'autres Espagnols, des paysans de la province d'Alicante, qui deviennent
maraîchers, des juifs sefardim, auxquels le décret Crémieux accorde la nationalité française, des
gitans tondeurs de chiens, rempailleurs de chaises et diseurs de bonne aventure. Les Maltais
suivent; certains sont transporteurs, ou meuniers lorsque s'édifie la " cité des Moulins ". D'autres
font paître leurs chèvres sur les flancs de la colline de Bouzaréa, au Frais-Vallon notamment, et
descendent vendre du lait, à domicile, aux clients. Les premiers mariages mixtes sont célébrés, car
les Espagnols ne sont pas insensibles au charme sauvage des brunes maltaises.
Gagayous un héros pittoresque
En 1900, on peut parler de Bab-el-Oued les Deux-Églises. On a, en effet, construit l'église
Saint-Joseph, tarabiscotée comme une pièce de pâtisserie saupoudrée de sucre, et cette blanche
construction fait face à la silhouette jaune de Notre-Dame d'Afrique " Madame l'Afrique ",disent les
Algériens de la Casbah, également bâtie, à cette époque, sur les hauteurs. Le tramway, dont les rails
suivent la côte jusqu'à la corniche de Saint-Eugène , succède à la voiture à chevaux, aïeule de tous
les transports en commun.
Au début du siècle, de lourdes bâtisses aux façades blanches ou ocre, construites dans un style
colonial que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les villes hispaniques des Caraïbes, transforment
le paysage entre la colline de Bouzaréa et l'étroite bande de sable jaune longeant la mer, face aux "
bains Matarese ". Le coeur de cet ensemble est la place des Trois-Horloges, qui doit son nom, en
fait, à une seule horloge à trois cadrans, étonnante pièce de fonte surmontée d'une grosse boule
blanche.
Le publiciste Auguste Robinet, dit Musette, campe, dans un livre bien vite célèbre, le héros
picaresque qui symbolise tout Bab-el-Oued : Cagayous. On voit vivre, dans le petit monde de
Cagayous, tous les acteurs bien typés de la commedia dell'arte que joue, pour les autres et pour
lui-même, le petit peuple du quartier : Chicanelle, ma soeur, pôvre, qu'elle élève toute seule le petit
Scaragolette, Calcidone, le pêcheur d'oursins, Pimient, le marchand de tabac, Coimbra, le fossoyeur,
Mecieur Hoc, le facteur, Courro le fier-à-bras, Bacora le guitariste, Félisque le ténor, Embrouilloune,
l'Apolitain (le Napolitain), Ugène, le louette (le rusé), Fartasse (le Chauve), tape-à-l'oeil, Gasparette et,
enfin, çui-là qu'il a la calotte jaune, l'homme qui se cache de la police et dont on ne connaîtra jamais
que ce long pseudonyme.
Entre les deux guerres, les Siciliens, qui s'étaient d'abord dirigés sur Chiffalo, et les Napolitains, qui
avaient d'abord mis le cap sur Philippeville et Bône, prennent partiellement le relais de l'émigration
espagnole et viennent se fondre, avec quelques Français méridionaux, dans le melting pot
méditerranéen, dans le grand mélange qui donne à Bab-el-Oued son originalité pittoresque et
colorée. Si l'on descend l'avenue Durandon, on peut voir que cette frontière sépare le vieux
Bab-el-Oued des rivages ibériques, à gauche, du néo-Bab-el-Oued du Mezzogiorno italien, à droite.
Le pataouète, " ce rameau sur la souche des langues d'oc ", selon l'excellente définition de Gabriel
Audisio, continue à forger impétueusement, sur une toile de fond française, sa syntaxe exubérante
et son vocabulaire concret empruntant sans complexe ses locutions à l'espagnol - catalan,
valencien ou castillan -, aux versions napolitaine et sicilienne de l'italien, au maltais, au provençal, à
l'arabe.
En 1956, l'influence spécifiquement française s'est fortement accentuée et le pataouète, tout en
demeurant largement ésotérique pour le francaoui (le métropolitain), s'est tout de même rapproché
du français naturel, celui qu'on parle en Beauce ou en Touraine. Un certain vent de modernisme a,
d'autre part, soufflé sur Bab-el-Oued, dont la population ne cesse de s'accroître (80000 habitants en
1952, 100000 quatre ans plus tard).
Les H. L. M. poussent maintenant comme des champignons sur les terrains vagues et parfois à la
place de vieilles maisons rasées. Des voitures de plus en plus nombreuses sillonnent des rues de
plus en plus embouteillées.